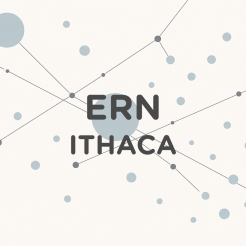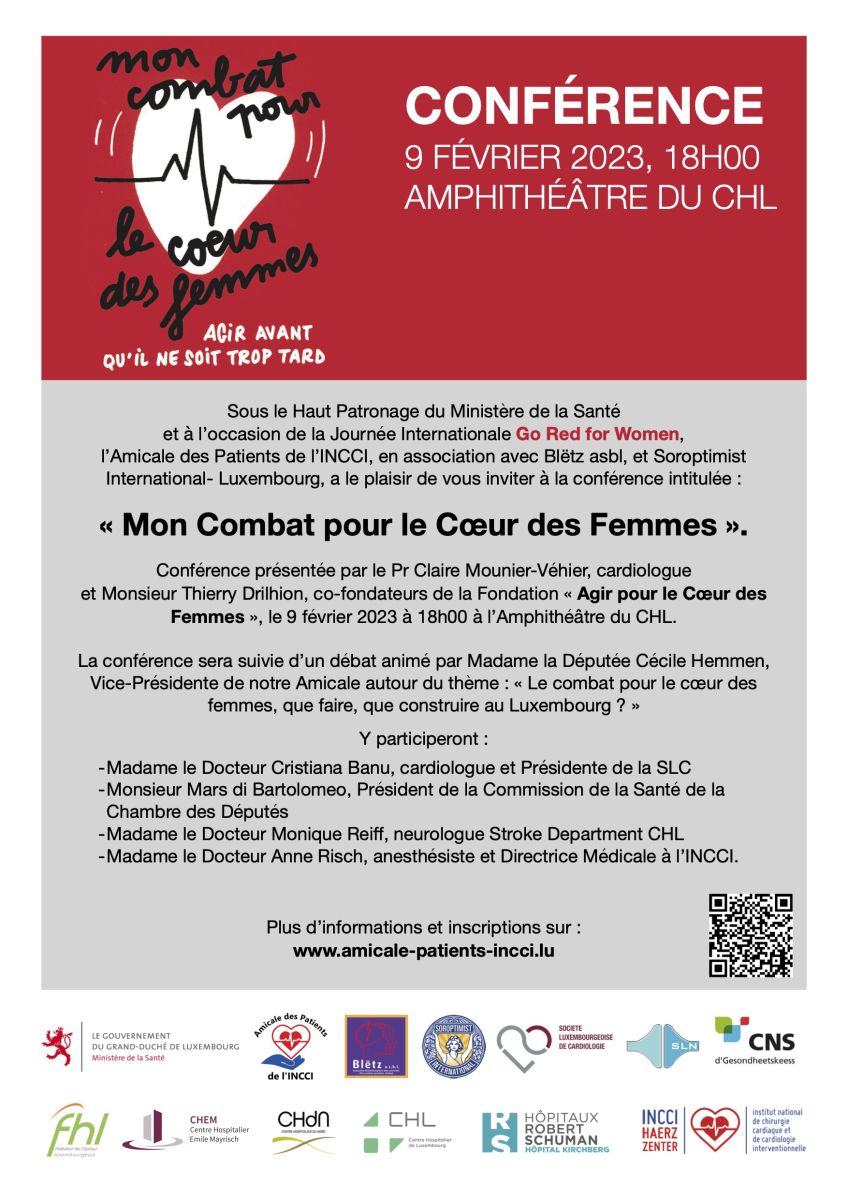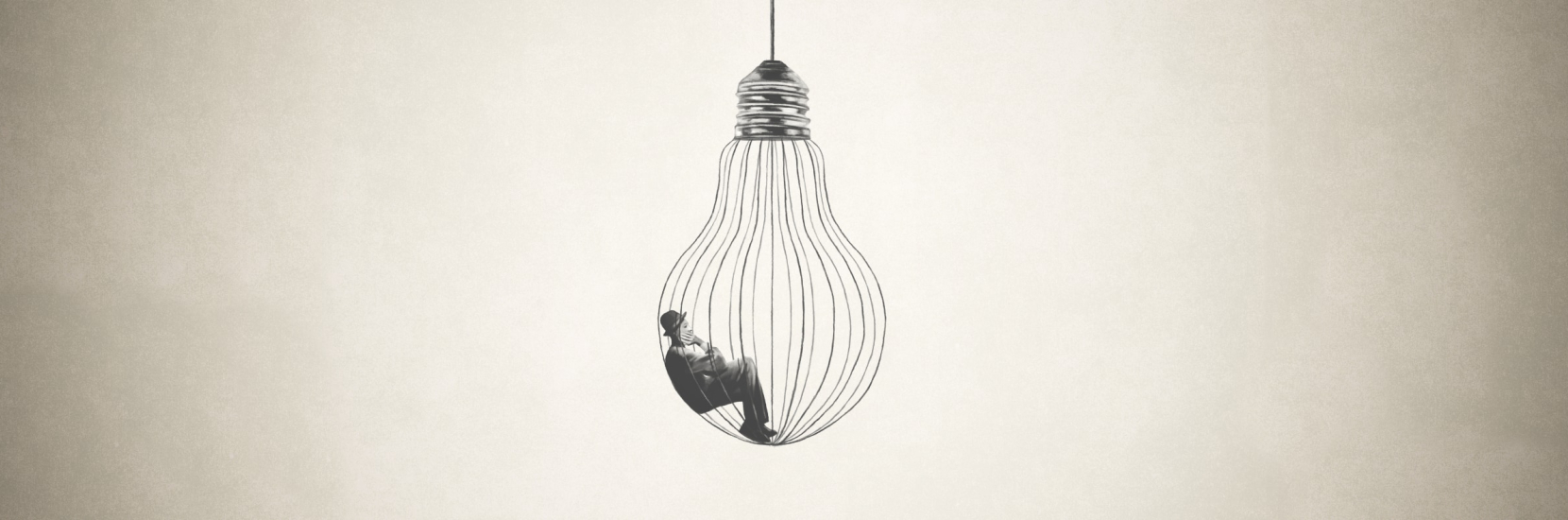Dr Karin MICHALSKI a rejoint le service d’Evaluation et de Rééducation Fonctionnelle de la Pédiatrie du CHL le 15 octobre 2022 en tant que médecin spécialiste en pédiatrie.
Dr MICHALSKI est docteure en médecine, chirurgie et accouchement (UCL, 1996) et titulaire de la spécialisation en pédiatrie et médecine des adolescents (Bezirksärztekammer, Trêves 2003).
Elle a complété son cursus de formation spécialisée entre 1996 et 2003 en Allemagne, au Luxembourg et en France dans les domaines suivants :
- Pédiatrie générale et néonatalogie.
- Néphrologie pédiatrique et dialyse.
- Soins intensifs pédiatriques.
- Neuropédiatrie.
Depuis 2003, Dr MICHALSKI a exercé en tant que médecin-pédiatre au Luxembourg : d’abord en tant que médecin résident au CHL (jusque 2005) puis comme médecin indépendant en cabinet pédiatrique.
Langues parlées :
- Luxembourgeois
- Français
- Allemand
- Anglais